 |
olivier godechot |
LES COMMENTAIRES | COMMENTS

74 messages Ajouter un commentaire
Add a commentContacter le Webmestre
Contact the Webmaster
MONTEBELLO Fabrice @ (2008-05-12 16:47:50)
Bonjour je me permets d'apporter cette modeste contribution à votre étude académique, un "essai d'évaluation du localisme dans le monde académique". Cet article a suscité un débat au sein de certains chercheurs de mon laboratoire d'appartenance (2L2S, laboratoire Lorrain de Sciences Sociales, U. de Metz et de nancy 2). Je l'ai lu très rapidement et j'ai réagi tout aussi rapidement. Bien que membre de ce laboratoire de sociologues, je suis historien de formation, spécialisé dans l'histoire du cinéma et je vous remercie par avance de votre indulgence quant à certaines affirmations qui pourront vous paraître naïves. Votre article a fait l'objet de discussions au sein de notre petite communauté et c'est certainement la preuve de sa qualité. Je ne partage pas ce que je crois être certains présupposés qui biaisent selon moi les résultats de l'enquête et qui sous la plume de certains journalistes peuvent avoir des effets directement politiques (pour le dire vite "pro-sarkosystes") que personnellement je déplore. Voici la réponse spontanée que j'ai envoyée à l'ensemble de mes collègues. Je la restitue telle quelle. je vous remercie pour votre attention, cordialement, Fabrice Montebello (U. de Metz) : "Ce qui est surtout intéressant c'est le fait que les auteurs ont décidé de qualifier les pratiques de "favoritisme" (qu'ils essaient d'objectiver quantitativement) à partir de l'usage systématique - à commencer par le titre - de "localisme". Bien qu'ils précisent que le "local" ne renvoie pas forcément à un ancrage territorial mais également à des espaces sociaux (des réseaux, des disciplines, certaines universités ou grandes écoles), ils ont du mal à faire disparaître l'impensé de leur pensée et ce que n'importe quel enseignant- chercheur associe spontanément dans cette situation et à partir de sa propre expérience à la tension Paris (�??universel�?�) province (�??local�?�). Si bien que cet article de bonne tenue demeure traversé, malgré tout, par des "a priori". Celui de la page 5 vaut son pesant de cacahuètes : "un même taux de recrutement de locaux ne saurait non plus être interprété de la même façon dans une université d�??élite et dans une université de second rang. Dans une période où le nombre de candidats produits est très supérieur au nombre de postes offerts, il pourrait découler plutôt de la qualité des candidats dans la première et d�??une forme de faveur dans la seconde". Conclusion : La "qualité" pour l"'élite", la recommandation maffieuse pour les ploucs de province. Il faudra qu'on m'explique par quel miracle social, l'élite serait préservée de toute forme de "favoritisme". Si il existe des universités d'élite et des universités de second rang, alors le recrutement du local de "second rang" est forcément adapté à une qualité de "second rang". En ce cas, où se trouve le favoritisme ? Comme pour la qualité artistique, une analyse, en termes de qualité, qui fait fi de la situation a toute les chances de taper à côté de la plaque et de ne retenir des enjeux de pouvoir et de réseaux, précisément, que des enjeux de pouvoir et de réseaux. Quand bien même, et en acceptant de demeurer dans ce registre, on peut tout aussi bien pointer des formes de localisme parisien complètement institutionnalisées, comme les modes de recrutement des grandes écoles détournées de leur fonction initiale (recruter à l'ENS pour le secondaire les meilleurs enseignants qui atterrissent pour la majorité d'entre eux dans le supérieur, recruté à l'ENA le personnel administratif qui atterrit dans les entreprises privées ou qui sert à alimenter le personnel politique, etc,...). En ce cas, et si nous prenons au sérieux l'évaluation d'une institution aussi peu "révolutionnaire" ou "bourdieusienne" que le Sénat se lamentant dans un rapport récent de la chute considérable en 20 ans de la proportion de fils d'ouvriers au sein des grandes écoles (de 30% à 8%), alors la tension Paris-province dénoncée implicitement dans cet article (et dans un seul sens), illustre les logiques de concurrence impitoyable au sein des petites-bourgeoises intellectuelles et des classes moyennes avec les quelques "fils du peuple" en outsiders et/ou alibis traditionnels de la méritocratie républicaine. C'est une autre expérience amère que les privilégiés que nous sommes avons affaire, celle de la sélection de candidats toujours plus nombreux et toujours plus brillants pour des postes de plus en plus rares et de moins en moins protégés. La logique systématique de l�??évaluation et de l�??auto-évaluation des enseignants et des enseignements telle qu�??elle est portée actuellement par l�??air du temps illustre les formes de réorganisation du marché académique. La province ayant réussi a inventé des formes de contre-pouvoir �??institutionnelles�?� tout aussi redoutable que les logiques de reproduction sociale parisienne, la �??qualité�?� du chercheur est en passe de devenir, la justification, en dernière instance, de sa compétence. Une telle adéquation avec le �??bon sens�?� (y compris avec celui de cet abruti de Sarkosy) devrait nous satisfaire, à condition encore une fois de ne pas réduire l�??objectivation �??favoritiste�?� au seul �??localisme�?� de province. Amitiés, Fabrice."
[Commentant cette page : hopcommentaires.php]
OgO (2008-05-06 22:32:54)
@Ullmo Merci pour votre commentaire. Très instructif. Je me doutais bien que les choses ont commencé à bouger en mathématiques depuis 5/6 ans mais pour l'instant je n'ai pas les données pour le mesurer. Le système de surveillance des concours que vous avez mis en place y contribue. Pour votre suggestion... je n'ai pas vraiment de données pour le mesurer complètement. Les indicateurs de publication sont partiels pour évaluer les compétences requises pour le poste de MCF, longs et coûteux à collecter et différents selon les disciplines (importance ou non des livres... etc.). Ce serait bien sûr instructif. Cela dit, je regarde tout simplement la relation entre localisme et succès à l'exportation... Et la relation est conforme à ce qu'on attend. Les départements les plus localistes sont ceux qui ont le plus de difficulté à l'exportation. Ou plus exactement, c'est peut-être parce qu'ils ne peuvent pas exporter leurs docteurs qu'ils deviennent localistes.... OGo
[Commentant cette page : hoparticle.php?id_art=505]
Emmanuel Ullmo @ (2008-05-06 21:55:26)
Merci beaucoup pour votre article qui quantifie les problèmes de localisme dans les recrutements universitaires. Voici quelques réflexions d'un président de commission de spécialistes en mathématiques à Orsay pas forcément transposable à d'autres disciplines notamment expérimentale. Nous avons décidé depuis de nombreuses années de supprimer toute forme de localisme dans nos recrutements et j'ajoute que les grands départements comparables ont suivis une politique voisine. Nous ne considérons aucune candidature d'un thésard issue de notre université et nos maîtres de conférences ont totalement intégré le fait que nous ne considérerons pas leur candidature pour un poste de professeur au sein de notre département. Dans plusieurs cas récents nous estimions certains dossiers locaux de plus haut niveau que ce que nous avons recruté. Dans tous les cas limites nous avons considéré que le critère de localité même minimal interdisait de considéré la candidature (ex thèse soutenu dans une autre université sous la direction d'un professeur venant de muter dans notre université, thèse soutenu dans notre département sous la direction d'un membre quittant le département). Nous proposons la plupart du temps des profils aussi large que possible (en général "mathématiques pures et appliquées"). Ceci est possible en partie car la plupart des mathématiciens recrutés sont capables d'enseigner dans presque toutes les filières (ce qui est probablement pose plus de problèmes dans d'autres disciplines). Nous ne retenons donc comme critère de recrutement que ce qui nous semble être l'excellence scientifique essentiellement de manière indépendante des thèmes de recherches. Grâce à cette politique, une grande majorité de nos maîtres de conférences passent rapidement une habilitation et deviennent professeur dans une autre université. Nous avons donc régulièrement des postes de MCF en nombres (environ 5 chaque années) correspondant à ces départs. Nous recevons pour ces 5 postes environ 300 dossiers de candidatures et 80 pour les postes de professeurs. Il me semble que c'est un élément clef de la réussite du département (3 medaille fields dans les 15 dernières années, 2-ème département au monde en terme de publication après Princeton mais devant Harvard ou le MIT). Il me semble qu'un sujet d'étude crucial pour des sociologues serait d'étudier le lien entre taux de recrutement local et réussite des départements. Je ne sais absolument pas comment mettre en place les outils d'une étude de ce genre mais je serais très intéressé par une étude de ce genre de la qualité que celle que vous avez produit. Bien cordialement, Emmanuel Ullmo
[Commentant cette page : hoparticle.php?id_art=505]
BC (2008-04-04 12:24:26)
le JO en ligne, ce n'est que le JO "lois et décrets" malheureusement. Pas le JO "associations" (en partie ailleurs), ni non plus le JO des séances de l'A.N. et du Sénat... un début...
[Commentant cette page : hopliens.php?action=lien&id_lien=127]
Jean-Michel @ (2008-02-24 15:30:25)
Je connaissais R mais je n'ai jamais testé (rebuté par la phase d'apprentissage). Quels seraient les arguments pour convaincre un sociologue de s'y mettre plutôt que de se contenter des outils propriétaires (Modalisa dans mon cas) ?
[Commentant cette page : hoprubrique.php?id_rub=65]
Philippe @ (2008-02-05 22:44:38)
Bonjour
[Commentant cette page : hopcommentaires.php]
Une très brève réaction au sujet de votre article du monde. Pour ne pas être répétitif, je passe sur un certain nombre de choses signalées par des posts précédants et sur lesquelles vous avez déjà réagi. Il me semble que le contexte et les personnalités en présence jouent un rôle très important sur les effets plus ou moins pervers du localisme et de tout système mandarinal. L'école mathématique française, par exemple, a été une des plus créatives au monde grâce à la surprotection qu'elle a longtemps accordé à ses chercheurs et au "despotisme éclairé" de ses mandarins : Laurent Lafforgue dit qu'il n'aurait pas pu poursuivre le travail de longue haleine qui lui a valu la médaille fields sans les conditions très favorables (exemptes de toute exigence de rentabilité) dans lesquelles il a rédigé sa thèse. Je sais que l'exemple est biaisé - le pédigré de Lafforgue avant ça (major d'à peu près tout les concours passés) plaidait en sa faveur. Mais la recherche est aussi parfois un travail long, qui prend péniblement forme met du temps à s'inscrire dans un canon communicable. La confiance, le soutient d'une ou de plusieurs personnalités peuvent être des moyens d'encourager une recherche active. Dans les faits, ça ne se passe pas toujours, et rarement, comme ça. J'ai juste l'impression que l'excès de codification fait ipso facto tomber une chappe de plomb sur les exigences, les parcours, et en fin de compte les profils retenus. Il vaut toujours lieux qu'il puisse y avoir des trous, pour le meilleur comme pour le pire ; c'est souvent là, et plus qu'ailleurs dans les sciences humaines, que les choses les plus neuves ont des chances de se glisser.
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le reste. L'université française souffre de népotisme, de rigidité, d'une consanguinité excessive. Je m'amuse, lorsque je lis votre texte sur le marché du livre philosophique en France, vieux de plus de dix ans, à constater que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont aux commandes (et souvent, qui tiennent bien plus fermement la barre encore). Mais je me méfie de solutions centralisées si on ne donne pas en même temps les moyens d'ouvrir les mailles de la toile qu'on tend.
Bien à vous
Matthieu Morin @ (2008-02-05 12:21:38)
Salut cousin,
[Commentant cette page : hopcommentaires.php]
Je suis très impressionné par ton travail. Je trouve ça passionnant !
Je viens d'acheter ton livre sur les traders, je pense être assez grand maintenant pour pouvoir le lire ;)
Je lirai "Working Rich" un peu plus tard.
Les commentaires suites à tes interviews sont très intéressants également, permettant de prendre un peu de recul par rapport au récit que l'on peut lire dans les journaux.
Je regrette de ne pas avoir orienté ma carrière vers la finance et la sociologie.
Bonne continuation.
Matt
Gaël Villeneuve @ (2008-01-30 10:12:26)
Bravo pour ce travail de documentation sur cette affaire. Très drôle ce journaliste qui "demande l'exclusivité" de l'interview. Une pratique anglo-saxonne qui de ce que je sais, appelle une contrepartie impensable en France : de l'argent.
[Commentant cette page : hoprubrique.php?id_rub=32]
Olivier Godechot (2008-01-29 09:38:07)
@ Bromius Je ne suis pas forcément favorable aux concours tels qu'ils sont, mais si l'on veut éviter certains désavantages d'une compétition décentralisée et marchande, une procédure centralisée d'évaluation et de sélection peut être une piste intéressante. C'est encore plus vrai dans le cas français, où on a la décentralisation sans véritable compétition. En citant les concours prestigieux, je ne prends pas spécifiquement la défense de chacun. Je rappelle juste qu'avant de développer une politique de décentralisation à outrance, le centralisme peut avoir des bonnes raisons et produire des résultats généralement considérés comme de qualité. Je suis pour ma part depuis longtemps favorable à la fusion de l'agrégation du secondaire et du CAPES pour plusieurs raisons : 1) qu'à un seul poste (enseignant du secondaire) corresponde un seul concours 2) que dans le secondaire on respecte le précepte "à travail égal, salaire égal" et non "plus on travaille, moins on gagne" 3) pour éviter de figer pour toute une carrière les coups d'accordéon conjoncturels du recrutement. Agrégation de philosophie de 1969, 100 postes, Capes de philosophie 300 postes. 10 ans plus tard, 10 postes ouverts dans chaque concours.... Un agrégé de 1969 est beaucoup moins rare qu'un certifié de 1979 et il a passé un concours beaucoup moins "difficile" et pourtant il aura une meilleure carrière. 4) pour obliger l'enseignement secondaire à penser véritablement une politique d'avancement plutôt que de faire passer à des enseignants l'agreg interne 5) pour éviter enfin que les universitaires se dédouanent du travail d'évaluation propre à ce niveau en se reposant pour leur recrutement sur les résultats à un concours qui n'est pas fait pour eux. (En particulier en philosophie, histoire et littérature). Un moyen d'améliorer le travail d'évaluation au niveau du recrutement académique pourrait être de mettre au point des procédures spécifiques un peu plus mutualisées. Après lesquelles... je ne sais pas. Il est clair que les rumeurs de projets du gouvernement de suppression du CAPES et de conservation de l'agrégation vont complètement à l'encontre de ce que je propose... Pour les classes préparatoires... je ne sais pas trop quels sont les projets, les mettre dans les universités et réévaluer du coup les universités, pourquoi pas ? Mais encore faut-il qu'ils y arrivent... On ne casse pas comme ça aussi facilement le jouet de l'ensemble des élites.
[Commentant cette page : hopcommentaires.php]
Bromius @ (2008-01-29 08:52:56)
J'arrive sur votre excellent site à cause de l'actualité que vous savez... Rassurez-vous, il n'en sera pas question.
[Commentant cette page : hoparticle.php?id_art=302]
Etant vous-même agrégé, on n'est pas étonné de vous voir prendre la défense des concours et des classes préparatoires. Je suis moi aussi soumis à des déterminismes sociaux (docteur EPHE qualifié par le CNU, dépourvu de concours et bredouille après deux campagnes MCF & CNRS) qui sont parfaitement cohérents avec la manière différente dont je vois les choses... J'espère seulement que la raison n'est pas complètement absente des lignes qui suivent, et qu'un terrain d'entente pourrait être trouvé entre nous...
Sachez d'abord que j'approuve sans réserve votre proposition d'exeat post-doc. On ne comprend d'ailleurs pas pourquoi cette mesure n'est pas parvenue à s'imposer, alors qu'elle est réclamée par beaucoup depuis longtemps.
J'ai beaucoup plus de mal avec votre éloge assez laconique (voire simpliste, mais le format de votre tribune ne vous permettait pas de développer) de la sélection à la française.
Les concours d'histoire-géographie, que je connais d'assez près, offrent mille formes d'arbitraire (tête bien pleine > tête bien faite, codes comportementaux et culturels, humeur du jury, tirage aléatoire des sujets, etc) qui n'en font certainement pas un mode de sélection indépassable.
Au CNU (je connais surtout les moeurs de la section 21), certains dossiers, à en juger par les rapports produits (j'en ai lu plusieurs), sont traités par-dessus la jambe.
Cet arbitraire ne choquerait pas si les enjeux socio-professionnels n'étaient pas ceux que l'on sait (perspectives très moroses, en SHS en particulier).
Le clientélisme que la loi LRU vous fait craindre existe déjà, me semble-t-il. La fin du localisme ne suffirait pas à le supprimer. Vous connaissez comme moi des candidats extérieurs qui ont été désignés d'avance par des commissions sous influence. Avec renvois d'ascenseur.
Que pensez-vous des rumeurs faisant état d'une mort programmée des concours et des classes préparatoires? Pour ma part, je ne serais pas opposé à une intégration des filières d'élite dans une université qui aurait fait peau neuve (avec des moyens, naturellement !).
La question des concours reste à débattre (par quoi les remplacer ?). Il ne faut pas seulement reconnaître leurs vertus, mais aussi leurs vices. Chez les universitaires, ils consomment, au delà du raisonnable, beaucoup d'énergie (heures de préparations, corrections, publications de manuels, colloques "opportunistes") et génèrent des carrières qui ne sont parfois qu'un cursus honorum consacré à la seule gestion des ressources humaines du ministère (formation, évaluation, sélection, recrutement). La surface scientifique d'un grand nombre d'universitaires français en pâtit. Cette dépense d'énergie est aussi celle, ne l'oublions pas, des candidats, qui perdent parfois deux ou trois ans sans parvenir à leur fin (85% d'échec au CAPES d'histoire-géographie). Or ces années ne sont pas qualifiantes, en dépit du travail acharné qui est souvent fourni.
Les recrutements à l'université et la répartition des dotations se font également en fonction des concours. En histoire, cela a conduit à installer un cloisonnement entre des périodes découpées de manière pas toujours heureuse (antique, médiévale, moderne, contemporaine). Beaucoup de talents travaillant sur plusieurs périodes, ou sur des aires géographiques non-traditionnelles, ne sont tout simplement plus recrutés aujourd'hui. On assiste à un retour des profils académiques, formatés dès les années de préparation aux concours, qui préparent des thèses opportunistes ressemblant à de futures questions de programme.
Beaucoup de qualifiés au CNU pour peu de postes, dites-vous. Effectivement. Avec pour corollaire cette lamentable pratique du pré-classement par "piles" (d'un côté, ceux qui ont l'agrégation, de l'autre ceux, ceux qui ne l'ont pas). Enfin, ces nouveaux dossiers de candidature, dépourvus de publications, semblent affirmer sans honte: nous ne jugeons plus un candidat sur son travail scientifique, mais sur ses titres et ses réseaux.
Oui, le système de sélection à la française souffre d'un complexe de supériorité qui lui donne une fausse image de ce qu'il est en réalité ! La sociologie pourrait oeuvrer avec profit dans ce domaine, et éclairer les lanternes...
Bromius
[10 affichés - Reste 34]
Pages: index | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Garder le fil (rss) des commentaires
English |
Français
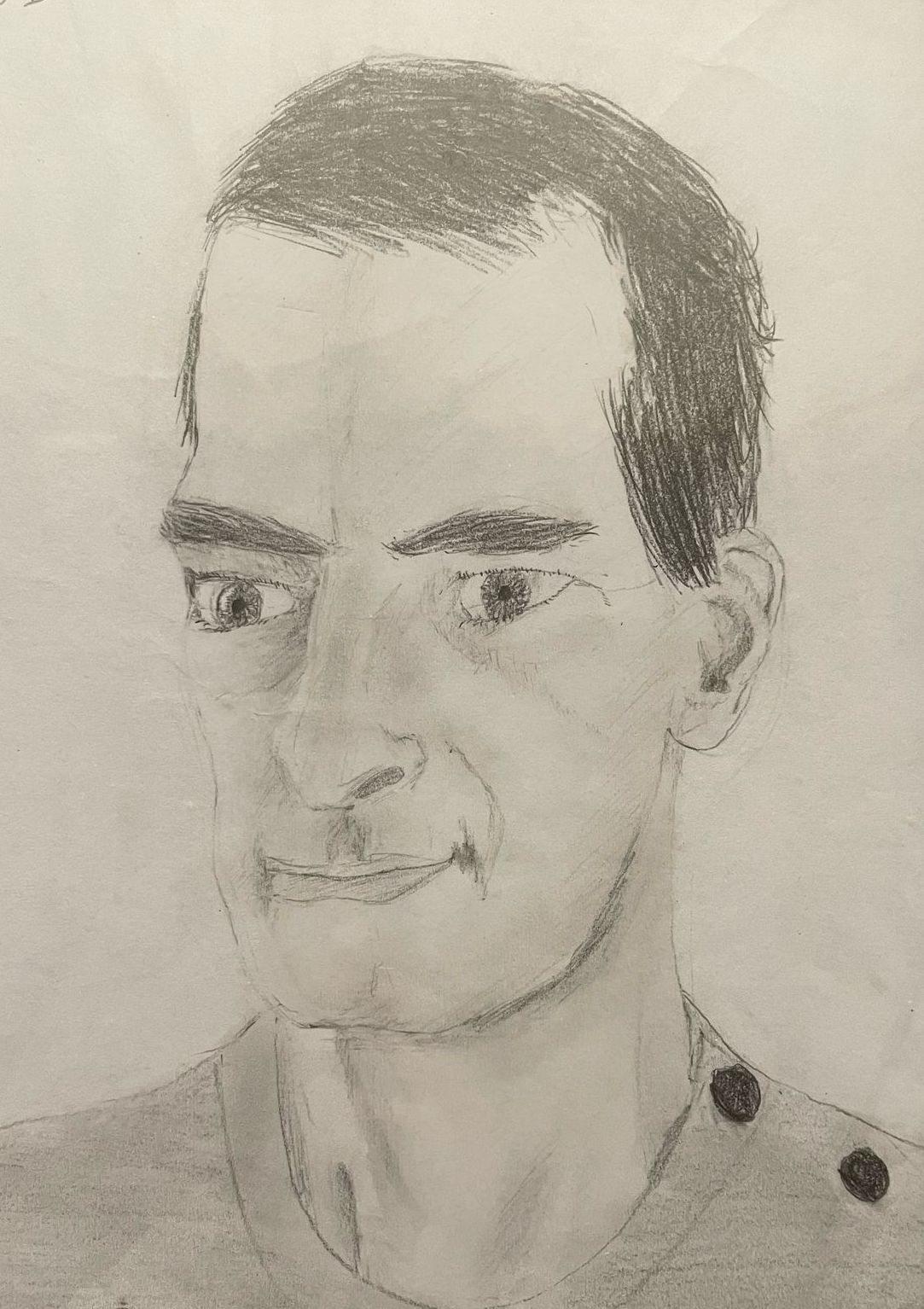

News 
OgO: plus ici|more here
[Publications] Publications moved, , Follow the link : http://olivier.godechot.free.fr/hoprubrique.php?id_rub=125: plus ici|more here
OgO: plus ici|more here
[Publications] Publications moved, , Follow the link : http://olivier.godechot.free.fr/hoprubrique.php?id_rub=125: plus ici|more here
HOP
A CMS