 |
olivier godechot |
La grande séparation : les salariés les mieux rémunérés travaillent de plus en plus ensemble et loin des autres
Une nouvelle étude permet de connaître la composition sociale de chaque établissement et de jeter un regard nouveau sur la question de la ségrégation sociale.
Atlantico : Vous avez participé à un travail de recherche collectif très impressionnant,"The Great Separation: Top Earner Segregation at Work in Advanced Capitalist Economies". Au regard de vos travaux, quelle est la réalité de la ségrégation salariale des pays de l’OCDE ? Ce phénomène touche-t-il de plus en plus les salariés ?
Olivier Godechot : Cet article publié dans l’American Journal of Sociology est le résultat d’un travail collectif de presque dix ans mené par une équipe de 29 chercheurs en sciences sociales ayant accès à des données administratives très détaillées, et souvent exhaustives, sur les salaires dans douze pays. Ces données permettent donc de connaître la composition sociale de chaque établissement et de jeter un regard nouveau sur la question de la ségrégation sociale. Nous faisons une analyse très simple, nous classons les salariées selon leur rang dans l’échelle salariale du pays et nous regardons pour une salariée donnée, faisant par exemple partie du top 10%, la part des collègues de son établissement qui font partie du même groupe salarial. Ainsi en début de période (1991), 28 % des collègues des salariées du top 10 % font aussi partie du top 10 %. Si les salariées étaient réparties au hasard, cette proportion devrait être de 10 % seulement. Ceci prouve que les salariées du haut de la hiérarchie travaillent relativement plus avec des salariées qui leur sont similaires que des salariées qui leur sont différentes. Qui plus est, cette proportion augmente. En fin de période (2017), elle atteint 34 %. Cet accroissement de l’entre-soi au travail est généralisé. On le constate dans tous les pays, à des rythmes variés, et il est particulièrement prononcé en France. De loin, l’évolution peut sembler limitée. Même si d’une année à l’autre, on ne voit guère de différences de ségrégation sociale, sur une période de trente ans, cela devient une évolution tout à fait remarquable. Qui plus est, le rythme d’évolution surpasse la croissance économique, ou encore celui d’augmentation des inégalités.
Les plus gros revenus travaillent-ils de plus en plus ensemble ? Les patrons sont-ils également concernés ?
Effectivement, le rythme d’accroissement de la ségrégation est nettement plus prononcé dans le haut de la hiérarchie des salaires. Dans certains pays, comme la France, on ne constate pas une dynamique similaire de concentration en bas de la hiérarchie des salaires. Au contraire, le bas se mélange avec le milieu. Mais le haut s’isole fortement des autres barreaux de l’échelle salariale. Ainsi, en France, entre 1993 et 2019, la part des collègues du 1% le mieux payé en France appartenant à la même tranche de salaire est passée de 9 à 16%. Les patronnes (en particulier les grandes patronnes) sont aussi concernées, même si nous ne les avons pas spécifiquement isolées dans l’analyse. Pour autant qu’elles soient salariées, ces personnes sont dans nos données, et constituent généralement une (petite) fraction du top 1 %. De fait, les sièges sociaux sont des établissements très homogènes socialement, avec des salariées très diplômées et à haut salaire.
Quelles sont les principales explications de cette ségrégation salariale ? Est-ce lié à l’évolution des lieux de travail ?
Notre étude met en évidence trois grands facteurs fortement intriqués : la désindustrialisation, le processus de restructuration des entreprises et la digitalisation.
L’industrie générait traditionnellement des lieux de travail avec une certaine diversité sociale : ouvrières, contremaîtresses, ingénieures, patronnes. Le fort déclin de l’emploi industriel et son remplacement par des nouveaux emplois dans les services, plus polarisés entre services à haute valeur ajoutée comme la finance et services à faible valeur ajoutée comme la restauration, contribuent donc au processus de ségrégation
En parallèle, lors des épisodes de restructuration des entreprises, les entreprises se « débarrassent » des salariées du bas de la hiérarchie, via des plans de licenciement, des recours à l’externalisation ou à la sous-traitance. Ces dernières continuent souvent de travailler pour les entreprises donneuses d’ordres, mais à distance, via des chaînes complexes de sous-traitance et d’externalisation. La digitalisation accompagne enfin ce mouvement, car elle permet la coordination à distance et permet de remplacer la subordination salariale par la subordination contractuelle.
Quelles sont les conséquences sur l’économie, pour les entreprises et sur le marché du travail ? Est-ce que cela modifie la société dans laquelle nous travaillons et vivons et sa cohésion sociale ?
Les entreprises voient généralement un avantage à « fissurer » les lieux de production en entités distinctes. Mais il peut y avoir des effets pervers qu’elles sous-estiment, en termes de coordination et de maîtrise des processus de production. Les effets négatifs sont plutôt du côté des salariées. Un travail trop fractionné dilue les responsabilités et dégrade les conditions de travail. Le travail étant un lieu de circulation de l’information, les salariées en contexte très ségrégué peuvent rater des opportunités. Cela diminue alors les chances de mobilité sociale. Comme la ségrégation au travail entraîne aussi de la ségrégation géographique, et donc scolaire, les salariées du bas de la hiérarchie peuvent se sentir plus généralement abandonnées par les élites.
Ce phénomène risque-t-il de s’aggraver ou de décroître dans les années à venir ?
Il est difficile de se prononcer a priori. D’un côté, les facteurs que nous avons isolés continueront certainement d’être actifs. Mais d’autres paramètres, comme l’intelligence artificielle, qui affecte surtout les milieux qualifiés, peut favoriser des tendances inverses. De fait, la hausse de la ségrégation s’est surtout déroulée entre 1995 et 2007. Au cours des années 2010, le rythme de croissance s’infléchit quelque peu.
Pourquoi la ségrégation des revenus au travail est un sujet peu étudié en sciences sociales?
En effet, si l’on s’inquiète, avec raison, des effets potentiellement délétères de la ségrégation, on l’approche en sciences sociales surtout en étudiant la répartition résidentielle des ménages et ce en se focalisant surtout sur la diversité des origines migratoires et ethno-raciales. On oublie que le travail est une sphère majeure de socialisation (générant des interactions plus fortes que le voisinage) et que la position dans la hiérarchie des revenus est le paramètre le plus important de structuration sociale.
Quelles seraient les pistes ou les mesures à prendre pour lutter contre ce phénomène ?
Notre travail ne fait pas de prescription normative. C’est à chaque acteur sociétal (syndicats, entreprises, partis) de se saisir de ce travail et de réfléchir à des dispositifs qui pourraient limiter la fissuration des collectifs de travail. On peut penser à des dispositifs pour re-responsabiliser (judiciairement et financièrement) le donneur d’ordres (comme par exemple renforcer la pénalisation des formes déguisées de prêt de main d’œuvre), ce qui inciterait plus à internaliser et limiterait le recours à la sous-traitance et à l’externalisation qui sont deux facteurs importants du processus. Notre travail conduit à souligner les limites des politiques sociales de réduction des inégalités internes aux entreprises. Dans la mesure où les inégalités se développent surtout entre entreprises, ces politiques risquent d’avoir une portée limitée.
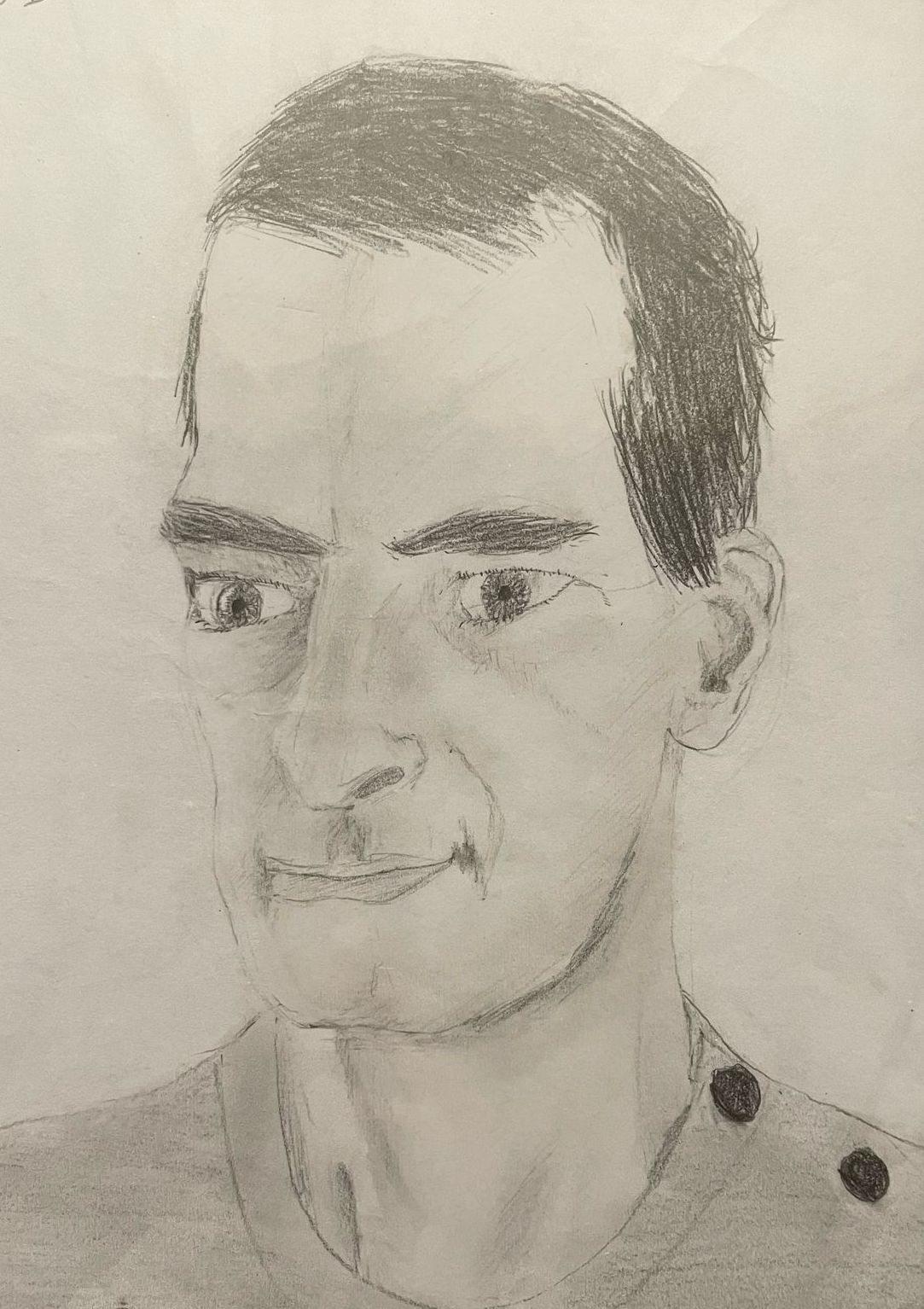

OgO: plus ici|more here
[Work in progress] Godechot, Olivier and Ulysse Lojkine. Intensification through outsourcing ...: plus ici|more here
[Presentations] 2025 Godechot, Olivier. 2025. “Economic separatism: Causes and consequences of the increase in top earner segregation”, Colloquium Series, Department ...: plus ici|more here
[Peer-reviewed articles] Godechot, Olivier, Mirna Safi, and Matthew Soener. 2025. “Organisational Intersectionality: Do Gender and Migration Status Inequalities Reinforce or Offset ...: plus ici|more here
[Home] Work in progress: plus ici|more here
[Publications] Publications moved, , Follow the link : http://olivier.godechot.free.fr/hoprubrique.php?id_rub=125: plus ici|more here
HOP
A CMS