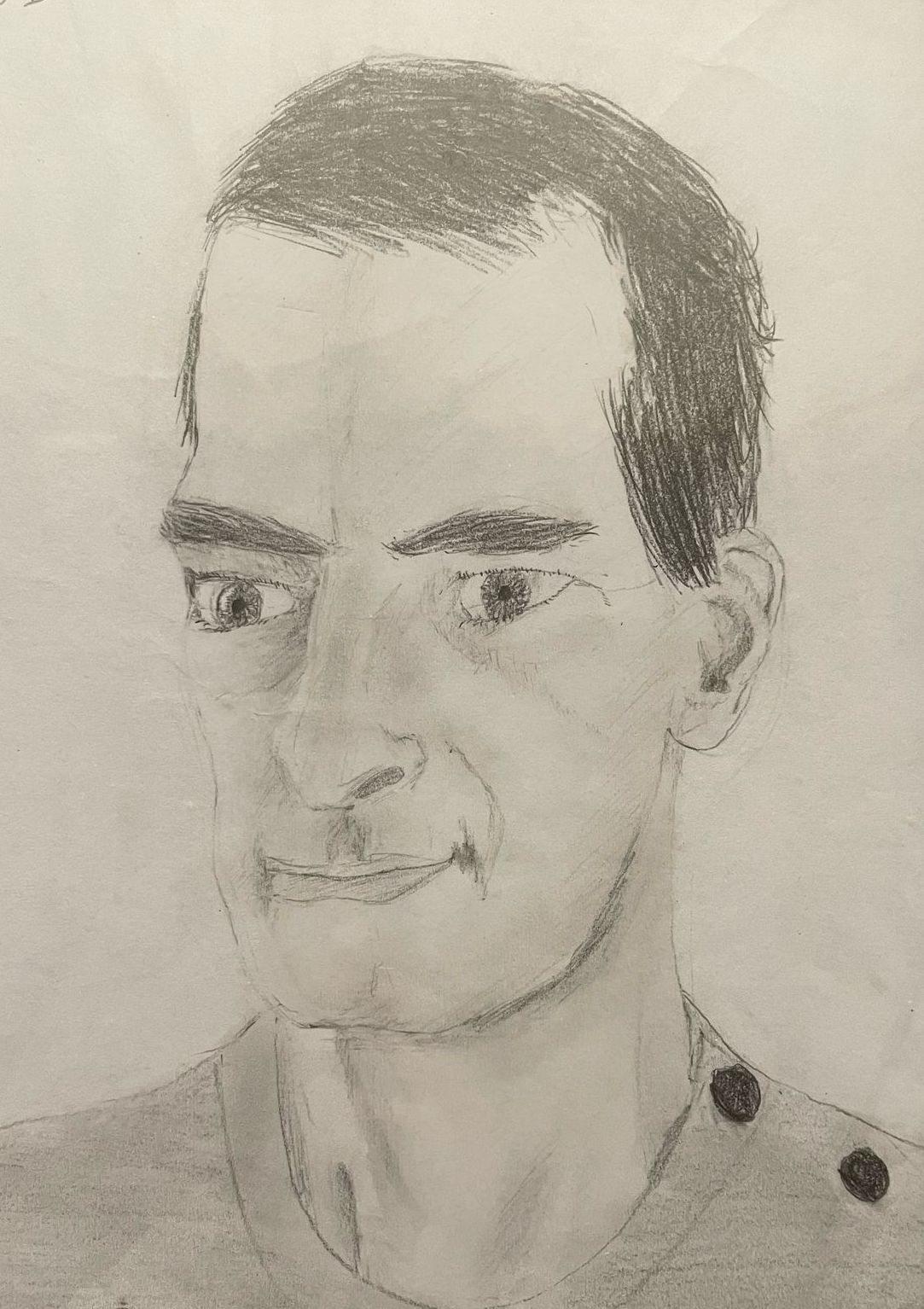Depuis le 13 Novembre et les attentats qui ont touché Paris, combien de fois avons-nous entendu cette phrase :
« Je ne connaissais personne parmi les morts, en revanche, il y avait des amis d’amis » ?
Des « amis d’amis », c’est tout près, ça signifie que nous avons des proches dans le deuil, qu’il faut les soutenir, que nous avons des récits de chagrin, d’enterrements, cela crée un effet de proximité très fort avec l’événement.
Depuis le 13 Novembre, je me pose une question : combien sommes-nous dans ce cas, à avoir perdu des « amis d’amis », des copains de relations, des « copains des enfants » ? Comment se fait-il que j’aie l’impression que ce nombre est gigantesque ?
Quelqu’un qui connaissait quelqu’un...
J’ai donc contacté un premier chercheur, Olivier Godechot, qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS et qui, par ses travaux sur les marchés financiers, en est venu à s’interroger sur les réseaux. Il m’a donné une première réponse, tout en m’orientant vers un collègue, « qui est beaucoup plus fort que moi pour ce genre de problèmes ».
Ce collègue s’appelle Camille Roth, il est chercheur au CNRS et travaille à l’interface entre les mathématiques et les sciences sociales sur la dynamique des réseaux, donc aussi sur les réseaux sociaux, les systèmes de construction de connaissances et la propagation de l’information.
Et, avec mille précautions, Camille Roth m’a donné une réponse : probablement aux alentours de 7 millions.
Aux alentours de 7 millions de personnes connaîtraient quelqu’un qui a perdu quelqu’un lors des attentats. C’est énorme : trois fois la population parisienne, les deux-tiers de la population francilienne, plus de un Français sur dix.
Avec ce chiffre, explique Camille Roth :
« Je ne serais pas surpris que la plupart des trentenaires parisiens connaissent quelqu’un qui connaît une victime, tandis qu’un retraité aux confins de l’Ile-de-France pourrait statistiquement faire un constat différent. »
Car, évidemment, ces 7 millions ne se répartissent pas à égalité dans les différents groupes socio-démographiques, ni sur le territoire français (sans compter que les réseaux de connaissances ne se limitent pas à la France, et pas seulement du fait que certaines des personnes décédées étaient étrangères).

La méthode
Camille Roth commence par préciser : « Faire appel aux réseaux réels des personnes est évidemment exclu, on ne peut que poser des conjectures quant aux paramètres. » Ce ne seront donc que des estimations.
Il poursuit (accrochez-vous) :
« En supposant que les 130 victimes ne se connaissent pas, avec une taille uniforme de voisinage social (en supposant que chacun connaît exactement n personnes), et étant donné un “taux de transitivité” c (c’est-à-dire, concrètement, le pourcentage de voisins se connaissant), on atteint quelque chose comme 130*n*[(n-1)*(1-c)].
Si l’on veut ne pas négliger les recoupements entre les réseaux des victimes, il faudrait connaître la taille des groupes d’amis qui ont conjointement été touchés aux terrasses des bars ou au concert. Imaginons qu’il s’agit de groupes uniformes de deux personnes (ce qu’on peut observer dans plusieurs récits), les voisins directs des victimes sont donc déjà affectés par ce phénomène d’interconnaissance, il faudrait probablement remplacer le premier n par “n*(1-c/2)”.
En outre, on sait que dans un réseau social, nos amis ont en moyenne davantage d’amis que nous : il s’agit du “paradoxe de l’amitié”, un phénomène mathématique apparemment contre-intuitif qui est dû au fait que, par construction, les individus qui ont plus d’amis sont plus susceptibles d’être nos amis (ils apparaissent par définition plus souvent dans le voisinage des individus) et sont donc sur-représentés dans les voisinages. Ici, le second n (celui de “n-1”) est vraisemblablement une sous-estimation de la réalité. »
La question, c’est comment évaluer n, le nombre de gens que « l’on connaît ». Pour cela, on peut avoir recours à différentes définitions de cette « connaissance » : cela va des relations sexuelles (définition en générale restreinte) au nombre de noms de gens que l’on peut identifier dans l’annuaire (définition très large).
Le modèle de l’« ami » Facebook
« En l’absence de meilleure intuition, on peut prendre la référence du réseau Facebook. Elle rend bien compte d’un type de connaissances dont on a des nouvelles (en effet, il faut être au courant qu’un voisin connaît une victime, l’info ne circulant pas forcément).
Si elle sous-évalue assurément le “vrai” nombre de connaissances, elle le sur-évalue par ailleurs du fait des connaissances dont on n’obtient pas nécessairement de nouvelles (a fortiori indirectement), même dans ces circonstances.
Ainsi, on peut fixer n à environ 250 personnes (nombre médian d’amis sur cette plateforme pour les 18-49 ans, d’après une étude récente du Pew Research Center), et c à 0,15 (suivant diverses études). Ce qui nous donne 7,8 millions de personnes en négligeant l’interconnaissance directe entre victimes, et 6,4 millions si on la prend en compte. Grosso modo, 7 millions de personnes. J’aurais tendance à imaginer qu’il s’agit d’une hypothèse conservatrice. »
Et les blessés ?
350 personnes ont été blessées le 13 Novembre ; peut-on estimer le nombre de personnes que cela touche à deux degrés ? Camille Roth précise :
« Mathématiquement, ça ne change rien à la formule (“Je connais quelqu’un qui connaît quelqu’un qui x”).
Par contre, le facteur important, et qui sous-tend d’ailleurs tout le raisonnement, est que la véritable relation qui importe ici (c’est-à-dire qui définit ce que nous considérons comme un lien dans le réseau) est liée à la circulation de l’information.
Or, intuitivement, on peut dire que la nouvelle d’un décès se diffuse plus certainement que celle d’une blessure (anecdotiquement, une amie aura ainsi appris tardivement qu’un de ses amis parisiens avait été touché à la jambe : cette info ne circule sans doute pas de la même manière, nommément à la même vitesse), donc n devrait être plus petit. »
Fixons n à 200, on arrive tout de même à près de 11 millions, qui s’ajoutent aux 7 millions évoqués plus haut. Soit 18 millions de personnes, qui connaissent quelqu’un qui connaît un mort ou un blessé.
Ajoutez encore ceux qui étaient présents au Bataclan, ou sur les lieux des fusillades et explosions, mais qui ne sont ni morts ni blessés, etc.
Bien sûr, il ne s’agit que de modèles, avec des hypothèses simplificatrices que l’on peut discuter et contester. Mais ils permettent de donner un ordre de grandeur. Ce qui n’est pas inutile car de cette proximité, ou impression de proximité, dépendent la manière dont on vit les attentats, et leur imprégnation à la fois sensible et politique.